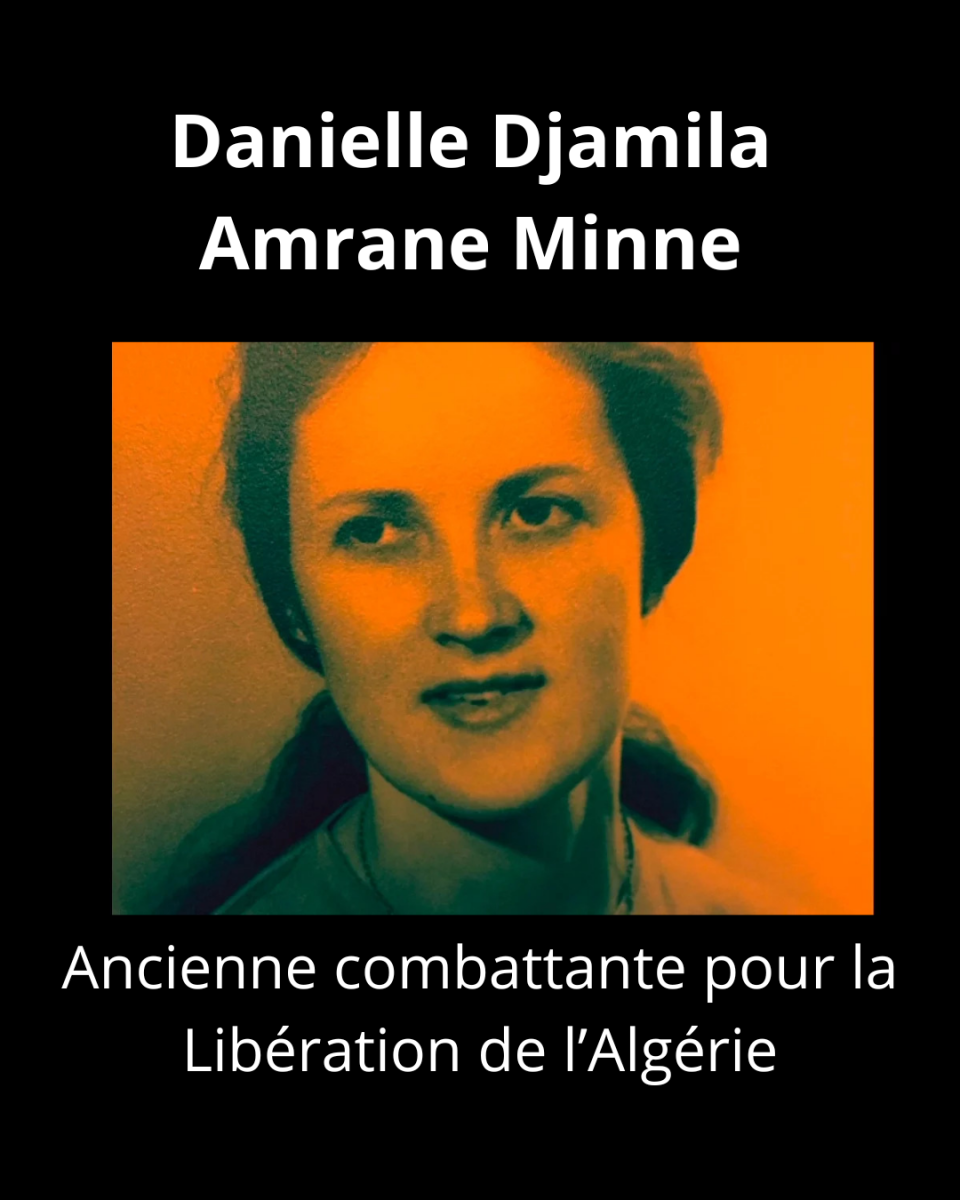Danielle Djamila Amrane Minne, ancienne combattante pour la Libération de l’Algérie
Danièle Djamila Amrane Minne
A lire sur Médiapart
Ancienne combattante pour la Libération de l’Algérie, algérienne d'origine européenne, fille de Pierre Minne surréaliste, libertaire et communiste et d'une mère communiste elle-même combattante de la liberté, Jacqueline Guerroudj, Djamila Amrane était une historienne combattante, une mère et une poétesse.
On lui doit une thèse publiée sur les engagements de femmes dans la guerre de libération de l'Algérie basé sur 88 entretiens de femmes résistantes : ces ouvrages sont des références incontournables sur la question. Avoir partager des faits d’armes avec celles qu’elle interviewait tout en ayant une solide formation universitaire la plaçait à un endroit qui défie la soit disant neutralité académique. Son travail est précisément profond de cette double formation : celle à l'université et celle au maquis.
Elle fut agent de liaison, maquisarde, fidaya, elle a risqué sa vie pour cet idéal partagé de Libération - l'on peut être très sérieux quand on a 17 ans, et ce en pleine bataille d’Alger.
Elle a récolté patiemment et avec acuité les récits de ses femmes, de cette "mafia des moudjahidate" comme je l'ai entendu nommée dans plusieurs bouches avec tendresse.
Pour ma part Djamila est la première personne que j'ai interviewée pour un documentaire et la première à m'avoir fait confiance en tant que réalisatrice : à m'ouvrir ses cahiers, ses archives, son carnet d'adresses sa maison et finalement son affection pour faire ce film Moudjahidate.
Son regard lumineux, exigeant, attentif et pétillant m'a accompagné avec patience et douceur dans cette quête de transmission de cette mémoire des femmes dans cette lutte anti-coloniale. Djamila est devenue une grand-mère de cœur pour moi, une ancêtre, une inspiration dans mon arbre généalogico-politique, l’incarnation d’une possible trajectoire politique. Une jeune femme blanche rompt avec le système colonial qui la privilégie, le court-circuite pour se placer aux côtés des colonisé.es qui se soulèvent.
Elle s'est engagée et a pris les risques nécessaires pour porter la lutte au même titre que les autres algériennes : les transports d'information et d'armes pendant la bataille d'Alger, infirmière au maquis, et puis encore debout en prison comme à celle de Rennes par exemple où elle maintiendra avec ses camarades suffisamment la pression auprès du directeur pour obtenir l'accès à la presse, à l’instruction : il fallait préparer l’avenir du pays indépendant.
Djamila aurait refusé que son origine européenne, c’est à dire le fait d'être blanche socialement lui confère plus d'égards ou de reconnaissance pour son engagement dans cette décolonisation de l’Algérie : pas si ces égards et cette reconnaissance ne furent pas collectifs.
Elle m'a accompagnée dans la réalisation de ce film parce que précisément il s’agissait d’interroger la définition de ce qu’est un militant ou une militante. Une définition « qui n’est pas toujours évidente » une définition qu’il s’agissait d’élargir, pour revaloriser tous les actes du quotidien et ceux déconsidérer car vu comme normal, ceux souvent pris en charge par des femmes : soigner les blessé.es aux maquis, nourrir et cacher des militant.es, transporter des documents, ou encore mettre son bébé dans les bras d’une moudjahida pour qu’elle puisse passer plus facilement un checkpoint : des actes sans armes essentiels qui sont légions.
Son écriture d’une d’une Histoire collective remettait en question les personnifications de l’héroïsme : le peuple entier était le héros.
Djamila ressemblait physiquement à ma grand-mère bretonne elle aussi décédée, Paix à leurs âmes.
Dans cette ère où règne le droit non plus international mais celui du plus fort,
dans les moments de gorges serrées et d’angoisse profonde comme l’État du monde et celui de la société française peut nous plonger, je sais que son héritage et sa force m’accompagnent, se déposent sur moi et sur sa famille, ses magnifiques enfants et petits-enfants.
Est-ce qu’on peut faire parler les fantômes ?
Qu’aurait-elle à nous dire et à nous apprendre sur le monde d’aujourd’hui ?
Ce qui est certain c’est qu’elle serait vocale sur les différentes formes de colonialisme et sur le génocide en cours perpétué par Israël sur le peuple palestinien.
Le dirait-elle par sa poésie ? Par une étude comparative socio-historique entre la place des femmes dans la lutte en Algérie et celle en Palestine aujourd’hui ? Trouverait-elle des analogies entre la manière de déshumaniser et délégitimer les différentes formes de résistances palestiniennes comme l’était celle du FLN dans les médias français ? Parlerait-elle des techniques de tortures d’État utilisées en Algérie et enseignées par le gouvernement français comme celles validées et acclamées au parlement israélien ?
Gageons qu'elle parlerait certainement du souffle et de la détermination que portait le peuple algérien dans la clandestinité et dans la rue jusqu’à sa victoire.
Un souffle une détermination, un sumud que l’on retrouve au milieu des ruines dans les mots des palestiniens et palestiniennes encore debout.
On ne fait pas parler les fantômes mais leur héritage déposé nous oblige,
tout comme leur amour transmis d’un idéal et d’un pays.
Un idéal qui nous rappelle de construire l’avenir et de le prendre à bras le corps
Tahia Djezaïr
Tahia Falestine
5 juillet 2025
Alexandra Dols
Femmage dans le cadre de la dénomination de la Maison du Parc départemental de la Bergère à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. 5 juillet 2025
Quelques jours après, la maison de la culture a été vandalisée par des tags racistes "mort aux algériens" et des croix de l'OAS/Gud. Cnews s'en était donné à cœur joie pour fustiger la dénomination " Honorer Danièle Djamila Amrane-Minne n'est ni inclusif, ni réparateur, c'est même tout le contraire."
Vidéo en ligne
En présence de
Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis
Pascale Labbé, Vice-présidente chargée de l'Observatoire départemental des
violences envers les femmes et de l'Égalité Femmes-Hommes
Belaïde Bedreddine, Vice-président chargé de l'Écologie urbaine
Dominique Dellac, Vice-présidente chargée du patrimoine culturel, de la mémoire,
du tourisme et de l'éducation artistique et culturelle
Oriane Filhol, Conseillère départementale déléguée chargée de la jeunesse et de
la lutte contre les discriminations
================
Danièle Djamila Amrane Minne
A former combatant for the Liberation of Algeria, Djamila Amrane was an Algerian of European descent, the daughter of Pierre Minne—himself a surrealist, libertarian, and communist—and of Jacqueline Guerroudj, a communist and freedom fighter in her own right. Djamila Amrane was a historian of struggle, a mother, and a poet.
She is known for a thesis published on the roles and commitments of women in the Algerian War of Liberation, based on 88 interviews with women resisters—works that have become essential references on the subject. Having shared in the very combat she chronicled, while possessing a solid academic training, placed her in a unique and powerful position—one that defies the supposed neutrality of academia. Indeed, her work is deeply enriched by this dual formation: that of the university, and that of the maquis.
She served as a courier, a maquisarde, a member of the fidayate—risking her life for a shared ideal of freedom. One can be very serious at seventeen, especially in the midst of the Battle of Algiers. With patience and keen insight, she collected the stories of these women—this "mafia of the moudjahidate," as I have heard them affectionately called.
For my part, Djamila was the first person I interviewed for a documentary, and the first to trust me as a filmmaker: she opened to me her notebooks, her archives, her address book, her home, and ultimately her affection, so that I might create this film Moudjahidate. Her radiant, exacting, and sparkling gaze accompanied me with patience and gentleness in this quest to transmit the memory of women in this anti-colonial struggle. Djamila became, for me, a grandmother of the heart, an ancestor, an inspiration on my own genealogical and political tree—the embodiment of a possible political trajectory. A young white woman broke with the colonial system that privileged her, sidestepping it to stand alongside the colonized as they rose in revolt.
She committed herself and took the necessary risks to pursue the struggle alongside other Algerian women: conveying information and arms during the Battle of Algiers, serving as a nurse in the maquis, and standing tall even in prison—as in Rennes, for example, where she and her comrades applied enough pressure on the warden to secure access to the press and to education. They needed to prepare for the country’s independent future.
Djamila would have refused that her European origins—that is, being socially white—afford her greater respect or recognition for her role in the decolonization of Algeria, not if those honors were not also collective.
She guided me in making the film precisely because it was about questioning what it means to be an activist—an identity, as she reminded me, that is “not always self-evident,” and one that must be broadened to revalue everyday actions, especially those devalued as simply “normal” and so often carried out by women: tending to the wounded in the maquis, feeding and sheltering militants, carrying documents, or placing one’s own baby in the arms of a moudjahida so she might more easily pass through a checkpoint. These unarmed, crucial acts are legion.
In writing a collective history, she challenged individual personifications of heroism: to her, the whole people were the true hero.
Djamila even bore a physical resemblance to my own late Breton grandmother, peace be upon them both.
In this era when the law of the strongest—not international law—prevails, in moments when the state of the world or of French society brings us to anxiety and a tightness in the throat, I know her legacy and her strength sustain me, enveloping both myself and her family—her beautiful children and grandchildren.
Can we give voice to the ancestors?
What would she have to say to us today, and what could she teach us about our present world?
One thing is certain: she would not stay silent about the many forms of colonialism and about the ongoing genocide perpetrated by Israel against the Palestinian people.
Would she express it through poetry? Through a comparative socio-historical study of the place of women in Algeria’s struggle then and Palestine’s struggle today? Would she find analogies in how the various forms of Palestinian resistance are dehumanized and delegitimized—just as the FLN’s resistance was treated by the French media? Might she recall the state torture methods used in Algeria and taught by the French government, methods now validated and even endorsed in the Knesset?
We can be sure that she would evoke the spirit and determination (le souffle) that carried the Algerian people in both clandestinity and in the streets to their final victory—a spirit, a determination, a sumud
that can be found today, even amid the ruins, in the words of Palestinians who are still standing.
We cannot truly make ghosts speak, but the legacy they entrust to us is our charge—just as is the love they pass down, an enduring love of an ideal and of a homeland.
An ideal that reminds us to build the future, to seize it with both hands.
Tahia Djezaïr
Tahia Falestine
July 5, 2025
Alexandra Dols
A tribute on the occasion of the naming of the Maison du Parc départemental de la Bergère in Bobigny, Seine-Saint-Denis, July 5, 2025. Just days later, the Maison de la Culture was vandalized with racist graffiti—“Death to Algerians” and OAS/Gud crosses. CNews took great delight in denouncing the naming, declaring: “Honoring Danièle Djamila Amrane-Minne is neither inclusive nor reparative; in fact, it is quite the contrary.”
En savoir plus
A lire sur Médiapart
Ancienne combattante pour la Libération de l’Algérie, algérienne d'origine européenne, fille de Pierre Minne surréaliste, libertaire et communiste et d'une mère communiste elle-même combattante de la liberté, Jacqueline Guerroudj, Djamila Amrane était une historienne combattante, une mère et une poétesse.
On lui doit une thèse publiée sur les engagements de femmes dans la guerre de libération de l'Algérie basé sur 88 entretiens de femmes résistantes : ces ouvrages sont des références incontournables sur la question. Avoir partager des faits d’armes avec celles qu’elle interviewait tout en ayant une solide formation universitaire la plaçait à un endroit qui défie la soit disant neutralité académique. Son travail est précisément profond de cette double formation : celle à l'université et celle au maquis.
Elle fut agent de liaison, maquisarde, fidaya, elle a risqué sa vie pour cet idéal partagé de Libération - l'on peut être très sérieux quand on a 17 ans, et ce en pleine bataille d’Alger.
Elle a récolté patiemment et avec acuité les récits de ses femmes, de cette "mafia des moudjahidate" comme je l'ai entendu nommée dans plusieurs bouches avec tendresse.
Pour ma part Djamila est la première personne que j'ai interviewée pour un documentaire et la première à m'avoir fait confiance en tant que réalisatrice : à m'ouvrir ses cahiers, ses archives, son carnet d'adresses sa maison et finalement son affection pour faire ce film Moudjahidate.
Son regard lumineux, exigeant, attentif et pétillant m'a accompagné avec patience et douceur dans cette quête de transmission de cette mémoire des femmes dans cette lutte anti-coloniale. Djamila est devenue une grand-mère de cœur pour moi, une ancêtre, une inspiration dans mon arbre généalogico-politique, l’incarnation d’une possible trajectoire politique. Une jeune femme blanche rompt avec le système colonial qui la privilégie, le court-circuite pour se placer aux côtés des colonisé.es qui se soulèvent.
Elle s'est engagée et a pris les risques nécessaires pour porter la lutte au même titre que les autres algériennes : les transports d'information et d'armes pendant la bataille d'Alger, infirmière au maquis, et puis encore debout en prison comme à celle de Rennes par exemple où elle maintiendra avec ses camarades suffisamment la pression auprès du directeur pour obtenir l'accès à la presse, à l’instruction : il fallait préparer l’avenir du pays indépendant.
Djamila aurait refusé que son origine européenne, c’est à dire le fait d'être blanche socialement lui confère plus d'égards ou de reconnaissance pour son engagement dans cette décolonisation de l’Algérie : pas si ces égards et cette reconnaissance ne furent pas collectifs.
Elle m'a accompagnée dans la réalisation de ce film parce que précisément il s’agissait d’interroger la définition de ce qu’est un militant ou une militante. Une définition « qui n’est pas toujours évidente » une définition qu’il s’agissait d’élargir, pour revaloriser tous les actes du quotidien et ceux déconsidérer car vu comme normal, ceux souvent pris en charge par des femmes : soigner les blessé.es aux maquis, nourrir et cacher des militant.es, transporter des documents, ou encore mettre son bébé dans les bras d’une moudjahida pour qu’elle puisse passer plus facilement un checkpoint : des actes sans armes essentiels qui sont légions.
Son écriture d’une d’une Histoire collective remettait en question les personnifications de l’héroïsme : le peuple entier était le héros.
Djamila ressemblait physiquement à ma grand-mère bretonne elle aussi décédée, Paix à leurs âmes.
Dans cette ère où règne le droit non plus international mais celui du plus fort,
dans les moments de gorges serrées et d’angoisse profonde comme l’État du monde et celui de la société française peut nous plonger, je sais que son héritage et sa force m’accompagnent, se déposent sur moi et sur sa famille, ses magnifiques enfants et petits-enfants.
Est-ce qu’on peut faire parler les fantômes ?
Qu’aurait-elle à nous dire et à nous apprendre sur le monde d’aujourd’hui ?
Ce qui est certain c’est qu’elle serait vocale sur les différentes formes de colonialisme et sur le génocide en cours perpétué par Israël sur le peuple palestinien.
Le dirait-elle par sa poésie ? Par une étude comparative socio-historique entre la place des femmes dans la lutte en Algérie et celle en Palestine aujourd’hui ? Trouverait-elle des analogies entre la manière de déshumaniser et délégitimer les différentes formes de résistances palestiniennes comme l’était celle du FLN dans les médias français ? Parlerait-elle des techniques de tortures d’État utilisées en Algérie et enseignées par le gouvernement français comme celles validées et acclamées au parlement israélien ?
Gageons qu'elle parlerait certainement du souffle et de la détermination que portait le peuple algérien dans la clandestinité et dans la rue jusqu’à sa victoire.
Un souffle une détermination, un sumud que l’on retrouve au milieu des ruines dans les mots des palestiniens et palestiniennes encore debout.
On ne fait pas parler les fantômes mais leur héritage déposé nous oblige,
tout comme leur amour transmis d’un idéal et d’un pays.
Un idéal qui nous rappelle de construire l’avenir et de le prendre à bras le corps
Tahia Djezaïr
Tahia Falestine
5 juillet 2025
Alexandra Dols
Femmage dans le cadre de la dénomination de la Maison du Parc départemental de la Bergère à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. 5 juillet 2025
Quelques jours après, la maison de la culture a été vandalisée par des tags racistes "mort aux algériens" et des croix de l'OAS/Gud. Cnews s'en était donné à cœur joie pour fustiger la dénomination " Honorer Danièle Djamila Amrane-Minne n'est ni inclusif, ni réparateur, c'est même tout le contraire."
Vidéo en ligne
En présence de
Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis
Pascale Labbé, Vice-présidente chargée de l'Observatoire départemental des
violences envers les femmes et de l'Égalité Femmes-Hommes
Belaïde Bedreddine, Vice-président chargé de l'Écologie urbaine
Dominique Dellac, Vice-présidente chargée du patrimoine culturel, de la mémoire,
du tourisme et de l'éducation artistique et culturelle
Oriane Filhol, Conseillère départementale déléguée chargée de la jeunesse et de
la lutte contre les discriminations
================
Danièle Djamila Amrane Minne
A former combatant for the Liberation of Algeria, Djamila Amrane was an Algerian of European descent, the daughter of Pierre Minne—himself a surrealist, libertarian, and communist—and of Jacqueline Guerroudj, a communist and freedom fighter in her own right. Djamila Amrane was a historian of struggle, a mother, and a poet.
She is known for a thesis published on the roles and commitments of women in the Algerian War of Liberation, based on 88 interviews with women resisters—works that have become essential references on the subject. Having shared in the very combat she chronicled, while possessing a solid academic training, placed her in a unique and powerful position—one that defies the supposed neutrality of academia. Indeed, her work is deeply enriched by this dual formation: that of the university, and that of the maquis.
She served as a courier, a maquisarde, a member of the fidayate—risking her life for a shared ideal of freedom. One can be very serious at seventeen, especially in the midst of the Battle of Algiers. With patience and keen insight, she collected the stories of these women—this "mafia of the moudjahidate," as I have heard them affectionately called.
For my part, Djamila was the first person I interviewed for a documentary, and the first to trust me as a filmmaker: she opened to me her notebooks, her archives, her address book, her home, and ultimately her affection, so that I might create this film Moudjahidate. Her radiant, exacting, and sparkling gaze accompanied me with patience and gentleness in this quest to transmit the memory of women in this anti-colonial struggle. Djamila became, for me, a grandmother of the heart, an ancestor, an inspiration on my own genealogical and political tree—the embodiment of a possible political trajectory. A young white woman broke with the colonial system that privileged her, sidestepping it to stand alongside the colonized as they rose in revolt.
She committed herself and took the necessary risks to pursue the struggle alongside other Algerian women: conveying information and arms during the Battle of Algiers, serving as a nurse in the maquis, and standing tall even in prison—as in Rennes, for example, where she and her comrades applied enough pressure on the warden to secure access to the press and to education. They needed to prepare for the country’s independent future.
Djamila would have refused that her European origins—that is, being socially white—afford her greater respect or recognition for her role in the decolonization of Algeria, not if those honors were not also collective.
She guided me in making the film precisely because it was about questioning what it means to be an activist—an identity, as she reminded me, that is “not always self-evident,” and one that must be broadened to revalue everyday actions, especially those devalued as simply “normal” and so often carried out by women: tending to the wounded in the maquis, feeding and sheltering militants, carrying documents, or placing one’s own baby in the arms of a moudjahida so she might more easily pass through a checkpoint. These unarmed, crucial acts are legion.
In writing a collective history, she challenged individual personifications of heroism: to her, the whole people were the true hero.
Djamila even bore a physical resemblance to my own late Breton grandmother, peace be upon them both.
In this era when the law of the strongest—not international law—prevails, in moments when the state of the world or of French society brings us to anxiety and a tightness in the throat, I know her legacy and her strength sustain me, enveloping both myself and her family—her beautiful children and grandchildren.
Can we give voice to the ancestors?
What would she have to say to us today, and what could she teach us about our present world?
One thing is certain: she would not stay silent about the many forms of colonialism and about the ongoing genocide perpetrated by Israel against the Palestinian people.
Would she express it through poetry? Through a comparative socio-historical study of the place of women in Algeria’s struggle then and Palestine’s struggle today? Would she find analogies in how the various forms of Palestinian resistance are dehumanized and delegitimized—just as the FLN’s resistance was treated by the French media? Might she recall the state torture methods used in Algeria and taught by the French government, methods now validated and even endorsed in the Knesset?
We can be sure that she would evoke the spirit and determination (le souffle) that carried the Algerian people in both clandestinity and in the streets to their final victory—a spirit, a determination, a sumud
that can be found today, even amid the ruins, in the words of Palestinians who are still standing.
We cannot truly make ghosts speak, but the legacy they entrust to us is our charge—just as is the love they pass down, an enduring love of an ideal and of a homeland.
An ideal that reminds us to build the future, to seize it with both hands.
Tahia Djezaïr
Tahia Falestine
July 5, 2025
Alexandra Dols
A tribute on the occasion of the naming of the Maison du Parc départemental de la Bergère in Bobigny, Seine-Saint-Denis, July 5, 2025. Just days later, the Maison de la Culture was vandalized with racist graffiti—“Death to Algerians” and OAS/Gud crosses. CNews took great delight in denouncing the naming, declaring: “Honoring Danièle Djamila Amrane-Minne is neither inclusive nor reparative; in fact, it is quite the contrary.”
En savoir plus